La France s’enfonce dans une crise politique profonde. Et au cœur de cette tempête se dresse un président désormais isolé. Conspué par ses adversaires, lâché par ses alliés et désavoué par l’opinion, Emmanuel Macron apparaît plus seul que jamais, sur les décombres d’un camp présidentiel qui n’est plus qu’un champ de ruines.

Le chef de l’État français, jadis perçu comme l’incarnation d’un renouveau politique, voit aujourd’hui son empire vaciller. En quatorze heures seulement, la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu a symbolisé l’effondrement d’une majorité devenue fantôme, un record d’éphémérité qui illustre la fragilité de l’exécutif.
« On est dans une crise de régime », a reconnu Hervé Marseille, président de l’Union des démocrates et indépendants (UDI). Un aveu rare dans une classe politique où l’on préfère d’ordinaire les mots feutrés aux constats brutaux.
Un président trahi par les siens
L’image est forte : deux anciens Premiers ministres de Macron, Gabriel Attal et Édouard Philippe, se désolidarisent publiquement de celui qui fut leur mentor. Le premier, secrétaire général de Renaissance, décrit un président « incompréhensible », enfermé dans « une forme d’acharnement à vouloir garder la main ». Le second, désormais chef du parti Horizons et candidat déclaré à la présidentielle de 2027, va plus loin : il appelle Emmanuel Macron à rendre le tablier dès 2026 pour organiser une élection anticipée.
Une trahison symbolique qui résonne comme un désaveu personnel et politique. Même ses soutiens historiques, à l’image du sénateur François Patriat, peinent à masquer leur inquiétude face à un exécutif dévitalisé.
Fin de règne et solitude du pouvoir
Pour l’analyste Mathieu Gallard (Ipsos), cette « atmosphère de fin de règne » tient à la volonté des anciens fidèles de se défaire d’un héritage devenu encombrant. En clair, le macronisme se meurt, rongé par ses contradictions internes et son isolement progressif.
Dans les couloirs du pouvoir, on évoque une « équation psychologique impossible à résoudre » : un président qui refuse de lâcher prise, même face à l’évidence du déclin. Certains parlent d’un suicide politique, d’autres d’un entêtement démesuré. Mais au-delà des murs de l’Élysée, c’est désormais dans la rue que la contestation s’organise et que s’exprime la colère.
Manifestations : de la colère sociale à l’exigence politique
Depuis la rentrée de septembre 2025, la France est secouée par une série de mobilisations sans précédent, témoignant du rejet croissant du président et de sa politique d’austérité.
D’abord centrées sur le pouvoir d’achat et la réforme des retraites, ces protestations ont progressivement pris une tournure politique, réclamant ouvertement la démission du chef de l’État. Le 10 septembre 2025, le mouvement citoyen Bloquons tout a ouvert la voie avec une journée nationale de blocages dans plusieurs grandes villes comme Paris, Lyon, Nantes et Toulouse. Né sur les réseaux sociaux, ce collectif non structuré a fédéré syndicats, étudiants et militants de la gauche radicale autour d’un mot d’ordre explicite : « Macron doit partir ». Le mouvement dénonçait « la confiscation du pouvoir par une élite déconnectée » et « l’effondrement des services publics ».
Quelques jours plus tard, le 18 septembre 2025, une intersyndicale nationale rassemblant la CGT Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), FO Force ouvrière (FO), la Fédération syndicale unitaire (FSU), Union syndicale Solidaires (ou SUD pour “Solidaires) et l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), a mobilisé plus de 500 000 personnes selon les organisateurs. Les cortèges, notamment à Paris et Marseille, ont dénoncé « la dérive autoritaire du pouvoir exécutif » et appelé à « une refondation démocratique ». Plusieurs pancartes réclamaient explicitement une élection présidentielle anticipée, en écho aux propos d’Édouard Philippe.
Enfin, le 2 octobre 2025, une nouvelle journée de grèves et de manifestations. La quatrième en moins d’un mois a confirmé la montée d’un rejet politique plus large.
Outre les syndicats, des collectifs citoyens et plusieurs figures de la gauche ont rejoint le mouvement, exigeant « la fin du macronisme » et « une transition démocratique pacifique ».
Certains élus de La France Insoumise et du Parti Communiste ont publiquement soutenu les appels à une dissolution et à un retour aux urnes.
Ainsi, de la colère sociale à la revendication politique, les mobilisations traduisent une crise de légitimité inédite sous la Ve République. Pour une partie des manifestants, il ne s’agit plus seulement de rejeter une politique, mais un système de pouvoir centré sur Emmanuel Macron lui-même, devenu le symbole d’un exécutif isolé et déconnecté de la société française.
Confiance en berne : les sondages traduisent le malaise
Les enquêtes d’opinion confirment ce désaveu. Selon un sondage Odoxa-Mascaret publié fin septembre 2025, Emmanuel Macron ne recueille que 22 % d’opinions favorables, soit son plus bas niveau de popularité depuis 2017.
Une tendance corroborée par l’institut BVA-Ipsos, qui note que 78 % des Français jugent que le président « ne comprend plus leurs préoccupations ».
En mai 2025 déjà, 71 % des sondés estimaient que son bilan était “mauvais”. Cette impopularité record se double d’un effritement de confiance au sein même de son camp, où plusieurs députés Renaissance ont pris leurs distances.
Contexte historique : les racines du séisme politique
Cette crise ne surgit pas du néant. Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024, Emmanuel Macron gouverne sans majorité claire, contraint de composer au cas par cas avec un parlement fragmenté. Les réformes successives : retraites, réduction des dépenses publiques, politique budgétaire restrictive, ont cristallisé la colère sociale.
L’annonce, en septembre 2025, du projet de loi de finances 2026 prévoyant de nouvelles coupes budgétaires dans la santé et l’éducation, a été l’étincelle de trop. C’est cette mesure, perçue comme injuste, qui a ranimé les braises d’un mécontentement latent depuis la réforme des retraites de 2023.
Une économie en tension : la politique au bord de la panne budgétaire
L’instabilité politique pèse désormais sur les indicateurs économiques. La croissance française, estimée à 0,6 % en 2025 selon l’Insee, marque un net ralentissement. La dette publique atteint 111 % du PIB, et les taux d’emprunt à dix ans frôlent les 3,8 %, signe d’une confiance fragilisée des marchés. Le pouvoir d’achat reste le principal moteur de la colère : inflation persistante sur les produits alimentaires, flambée des loyers, et hausse des prix de l’énergie ont accentué le malaise des ménages.
Les syndicats alertent sur un risque d’“explosion sociale” si le gouvernement ne renonce pas à certaines mesures d’austérité.
Les milieux économiques, eux, redoutent une paralysie prolongée. L’instabilité politique freine les investissements, notamment étrangers, tandis que les entreprises reportent leurs projets d’embauche.
Dans les faits, la crise politique devient économique, et le coût social du blocage se mesure déjà dans la baisse de confiance des ménages et des entrepreneurs.
Une présidence en sursis
Entre isolement politique, rejet populaire et pression économique, Emmanuel Macron fait désormais face à une équation quasi insoluble. Sa capacité à restaurer la confiance et à stabiliser le pays déterminera les prochains mois d’une présidence fragilisée. À défaut, la tentation d’une alternance anticipée par dissolution ou démission pourrait s’imposer comme l’issue la plus crédible à une crise de régime que la France n’avait pas connue depuis des décennies.
Eugène KAM








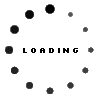

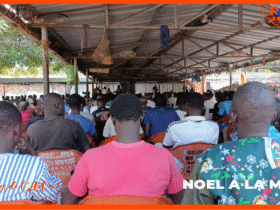
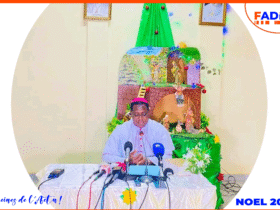
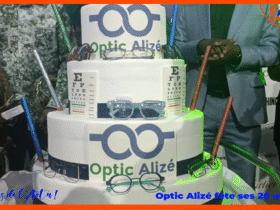

Laisser une réponse