Ouagadougou, 30 septembre 2025 – Après plus de vingt ans de coopération, le Burkina Faso a tourné la page de la Cour pénale internationale (CPI). Aux côtés du Mali et du Niger, les autorités burkinabè ont annoncé leur retrait du Statut de Rome, estimant que la juridiction de La Haye n’a pas répondu aux attentes initiales. Retour sur une relation jalonnée d’adhésion enthousiaste, de coopération prudente et de rupture assumée.

Une adhésion qui portait l’espoir de justice internationale
En avril 2004, le Burkina Faso ratifie le Statut de Rome et devient officiellement membre de la CPI. Déjà signataire du texte en 1998, le pays dépose son instrument de ratification le 16 avril 2004. Ce geste traduit la volonté des autorités d’alors de s’aligner sur les standards internationaux et de s’engager dans la lutte contre l’impunité.
Créée en 2002, la CPI a pour mandat de juger les auteurs des crimes les plus graves : génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression. Elle intervient lorsque les juridictions nationales échouent à rendre justice. Pour le Burkina Faso, cette adhésion incarnait l’espoir d’une justice internationale capable de renforcer l’État de droit et de combattre les violations massives des droits humains.
Pour de nombreux observateurs, l’Afrique voyait en la CPI « une avancée dans la construction d’un ordre mondial plus juste » (Makau Mutua, juriste kényan, Harvard Human Rights Journal). Le Burkina Faso entendait ainsi renforcer son image d’État de droit.
Vingt ans après son entrée en vigueur, le bilan de la Cour apparaît contrasté. Si elle a marqué l’histoire par certaines condamnations inédites, elle a aussi accumulé des revers nourrissant les critiques, en particulier sur le continent africain.
La CPI sur le terrain africain
Dès ses premiers dossiers, la Cour concentre son action presque exclusivement en Afrique. Des affaires emblématiques surgissent : Thomas Lubanga en République démocratique du Congo, première condamnation de la CPI en 2012 pour le recrutement d’enfants soldats ; Germain Katanga, condamné en 2014 à douze ans de prison ; Bosco Ntaganda, reconnu coupable en 2019 de crimes de guerre et crimes contre l’humanité ; ou Dominic Ongwen, condamné en 2021 à vingt-cinq ans de prison. Ces verdicts posent des jalons importants.
Mais la Cour connaît aussi des échecs retentissants. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président centrafricain, condamné en première instance, est acquitté en appel en 2018. Laurent Gbagbo, ex-président ivoirien, est lui aussi définitivement acquitté en 2021. Ces décisions fragilisent la crédibilité de l’institution aux yeux de nombreuses victimes.
À ces revers s’ajoutent des dossiers restés sans issue. Omar el-Béchir, visé par deux mandats d’arrêt depuis 2009 pour crimes de guerre et crimes de génocide au Darfour, n’a jamais été transféré à La Haye. En Libye, les poursuites contre Saif al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, sont au point mort faute de coopération des autorités locales. Recherché par la Cour pénale internationale (CPI), il est poursuivi pour crimes contre l’humanité en lien avec la répression violente du soulèvement populaire de 2011. Ces blocages révèlent la principale faiblesse de la CPI : sa dépendance à la volonté des États, souvent réticents à livrer leurs propres dirigeants.
Bien que certains verdicts aient marqué l’histoire, ils sont régulièrement remis en question par les attentes des victimes africaines quant à une justice véritablement universelle. En 2016, déjà, l’Union africaine dénonçait « une institution qui semble cibler prioritairement les dirigeants africains ».
Le Burkina Faso, sans être directement visé, partage ce ressentiment continental. Dans un contexte sécuritaire marqué par les attaques terroristes, les autorités burkinabè s’interrogent : pourquoi certaines violences majeures dans d’autres régions du monde échappent-elles à la CPI ?
Les insuffisances mises à nu
Au fil du temps, la CPI a été critiquée pour sa sélectivité et son inefficacité. « La Cour a ouvert des dizaines d’enquêtes, mais très peu se sont soldées par des condamnations définitives », note l’analyste français François Gaulme (Afrique contemporaine, 2020).
Des voix africaines, y compris burkinabè, estiment que la juridiction a échoué à répondre aux attentes de justice universelle.
En parallèle, le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire depuis 2025. Face aux violences, la CPI reste en retrait, laissant au pays le soin de gérer ses propres procédures judiciaires. Une distance qui renforce l’idée d’un instrument « déconnecté des réalités sahéliennes ».
Le tournant AES : une rupture collective
Le 22 septembre 2025, le Burkina Faso, avec ses partenaires du Mali et du Niger au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), officialise son retrait « avec effet immédiat ». La déclaration commune accuse la CPI d’être « devenue un instrument de répression néocoloniale, au service d’intérêts étrangers ».
La chercheuse ougandaise Sarah Nouwen, spécialiste de la justice internationale, soulignait déjà que la CPI risquait de perdre la confiance des États africains si elle ne démontrait pas son impartialité. Cet avertissement se confirme désormais avec la décision de Ouagadougou, Bamako et Niamey.
Selon le communiqué conjoint, ce retrait vise à « affirmer pleinement leur souveraineté » et à recourir à des mécanismes endogènes pour la paix, la justice et la protection des droits humains, selon leurs valeurs sociétales.
De l’enthousiasme de 2004 à la rupture de 2025, le Burkina Faso aura parcouru un chemin révélateur de la tension entre justice internationale et souveraineté nationale. En quittant la CPI, le pays prend une option politique claire : affirmer son indépendance judiciaire, quitte à se priver d’un mécanisme international conçu pour protéger les peuples.
Le pari burkinabè et sahélien sera désormais de démontrer que justice et souveraineté peuvent aller de pair.
Eugène KAM








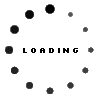
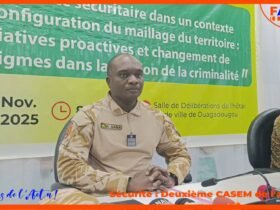




Laisser une réponse