L’image qui hante encore les écrans, c’est celle d’une foule compacte envahissant la place du 13 Mai à Antananarivo. Samedi 11 octobre, ce lieu emblématique de toutes les révolutions malgaches est redevenu le cœur battant de la contestation. Une victoire symbolique pour la rue, mais un tournant dramatique pour le pays. Depuis cette date, Madagascar vit dans l’incertitude la plus totale.

Le président Andry Rajoelina a disparu de la scène publique, l’armée se divise, l’Assemblée nationale vient d’être dissoute. Et nul ne sait vraiment qui gouverne encore la Grande Île.
Un chef d’État introuvable
Depuis trois jours, les rumeurs s’enchaînent sur les réseaux sociaux : le président aurait quitté le territoire.
Selon des informations relayées par Madagascar Aviation, l’hélicoptère présidentiel aurait décollé du Palais d’Iavoloha le 12 octobre pour rejoindre l’île de Sainte-Marie, sur la côte Est. Peu après, un avion militaire français de type Casa CN-235 aurait quitté l’île pour La Réunion.
Sur les images publiées, on verrait l’appareil rejoindre la zone militaire de l’aéroport de Saint-Denis, où stationnent justement les avions de transport de l’armée française.
Des sources évoquent ensuite un vol privé à destination de Dubaï.
Andry Rajoelina, lui, n’a pas démenti clairement. Dans un message diffusé sur ses canaux officiels, il reconnaît s’être “mis à l’abri dans un lieu sûr pour préserver sa vie”, sans dire où il se trouve.
Pendant ce temps, la CAPSAT, une unité militaire historiquement proche du pouvoir, a annoncé son refus d’obéir aux ordres jugés “contraire à la conscience nationale” autrement dit, tirer sur la population. Ce corps, qui avait pourtant aidé Rajoelina à renverser Marc Ravalomanana en 2009, rejoint aujourd’hui la contestation.
L’État au bord du vide
Face à cette mutinerie et aux appels à sa destitution, Andry Rajoelina a dissous l’Assemblée nationale le 14 octobre. Un décret publié sur les réseaux sociaux affirme que la décision a été prise après consultation des présidents des deux chambres.
Mais l’opposition crie à l’illégalité. Le président de l’Assemblée, Siteny Randrianasoloniaiko, conteste toute consultation et dénonce un “coup de force institutionnel”.
En réaction, 130 députés ont voté une motion d’impeachment contre le président, l’accusant d’avoir “abandonné ses fonctions” et “rompu le serment constitutionnel”. Le palais présidentiel rejette ce vote, estimant que le Parlement n’a plus compétence depuis sa dissolution.
Entre rumeurs d’exil, dissensions militaires et affrontement institutionnel, le pays semble suspendu entre deux légitimités : celle d’un pouvoir absent et celle d’une rue en effervescence.
Le mal profond : la rupture entre le peuple et son pouvoir
La crise actuelle n’est pas née d’un simple conflit politique. Elle est le fruit d’un désenchantement long et douloureux.
Depuis des années, les Malgaches vivent dans un quotidien marqué par les coupures d’eau, d’électricité, la cherté de la vie, le chômage et l’absence d’infrastructures fiables. Les grandes promesses de modernisation du président, routes, stades, “villes intelligentes” ont laissé place à la frustration.
Pour beaucoup, ces projets “vitrines” ne répondent pas à l’urgence du vécu : manger, se soigner, éduquer ses enfants.
Dans ce contexte, la mobilisation de la jeunesse malgache, très active sur les réseaux sociaux, a joué un rôle clé.
Les vidéos des coupures, des marchés vides ou des arrestations abusives ont circulé partout, donnant un visage à la colère. Les jeunes, souvent exclus du système économique, ont pris la tête du mouvement, transformant la place du 13 Mai en symbole de la reconquête populaire.
L’armée, nouveau centre de gravité
L’attitude de la CAPSAT change tout. Cette unité d’élite, clé dans la prise du pouvoir de Rajoelina en 2009, était jusqu’ici un pilier de son régime.
Son refus d’obéir aux ordres, puis son ralliement partiel à la contestation, montrent une fracture grave au sein des forces armées. Une partie de l’armée appelle désormais à une “transition républicaine”, dirigée par un Conseil militaire provisoire, le temps de rétablir l’ordre.
Sans le soutien de l’armée, le président perd l’essence même du pouvoir : le monopole de la force.
Ce basculement révèle une crise de légitimité totale. Même l’État-major hésite à suivre les ordres venus du palais, et les institutions civiles sont paralysées.
Dissoudre pour survivre
La dissolution du Parlement apparaît dès lors comme un acte de survie politique.
Rajoelina a voulu court-circuiter une Assemblée prête à le destituer. Mais en supprimant le seul contre-pouvoir démocratique, il aggrave la crise.
Le pays se retrouve sans Parlement, sans gouvernement stable, sans chef visible.
Un vide politique qui nourrit toutes les rumeurs, tous les appétits, toutes les peurs.
Les racines historiques d’un déséquilibre
Depuis l’indépendance, Madagascar vit une instabilité chronique : coups d’État, transitions inachevées, promesses trahies.
Chaque régime, qu’il soit civil ou militaire, s’est heurté aux mêmes fractures : un État central faible, une élite concentrée dans la capitale, une économie dépendante, et une population en quête de justice sociale.
Ce déséquilibre historique, hérité du passé colonial et nourri par la centralisation du pouvoir, a creusé un fossé entre gouvernants et gouvernés.
Aujourd’hui, cette faille s’élargit sous nos yeux.
Un pays sans boussole
Madagascar vit l’une des crises les plus profondes de son histoire récente.
Un président invisible, un Parlement dissous, une armée divisée, une population qui ne croit plus à ses institutions.
Trois chemins restent possibles : D’abord un dialogue national sincère, sous médiation africaine ou régionale, pour restaurer la confiance et éviter l’effondrement. Ensuite, des réformes institutionnelles visant à rétablir la séparation des pouvoirs et à renforcer la transparence. Et enfin une transition contrôlée, si le président ne revient pas ou si le vide du pouvoir persiste.
Mais chaque jour qui passe sans parole claire du chef de l’État accentue la peur du chaos.
Eugène KAM








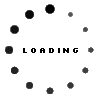

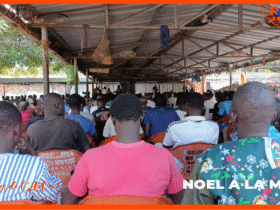
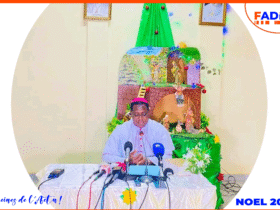
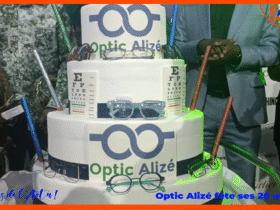

Laisser une réponse