
L’Éthiopie s’apprête à inaugurer, ce 9 septembre, la plus grande centrale hydroélectrique du continent africain : le barrage de la Grande Renaissance (GERD), construit sur le Nil Bleu.
Doté d’un gigantesque réservoir de 64 milliards de mètres cubes d’eau, ce projet emblématique lancé en 2011 aura nécessité 14 années de travaux et plus de 5 milliards de dollars (environ 3 000 milliards de FCFA) d’investissement.
Un projet porteur d’espoir pour l’Éthiopie
Avec ses 135 millions d’habitants, l’Éthiopie mise sur cette infrastructure pour sécuriser son approvisionnement énergétique, réduire sa dépendance aux énergies fossiles et exporter de l’électricité vers des pays voisins comme le Kenya ou Djibouti. Addis-Abeba y voit un levier stratégique pour stimuler sa croissance et accroître ses recettes en devises étrangères.
Des inquiétudes persistantes en Égypte et au Soudan
Si l’inauguration est présentée comme une victoire nationale par le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, elle reste source de tensions diplomatiques régionales.
L’Égypte et le Soudan, situés en aval du fleuve, dénoncent depuis des années les décisions unilatérales d’Addis-Abeba sur l’exploitation des eaux du Nil. Le Caire redoute une baisse significative du débit du fleuve, pouvant provoquer des pénuries d’eau et menacer son agriculture.
Selon les médias éthiopiens, l’Égypte continue de multiplier menaces et campagnes diplomatiques contre le projet, sans parvenir à freiner son achèvement.
Une inauguration sous pression
Cette controverse pourrait expliquer l’éventuelle absence de plusieurs chefs d’État africains et partenaires internationaux, pourtant conviés à la cérémonie par les autorités éthiopiennes.
Malgré ces tensions, l’inauguration du barrage de la Grande Renaissance marque une étape majeure dans l’histoire contemporaine de l’Afrique : un symbole d’ambition et de souveraineté énergétique, mais aussi une source de crispations géopolitiques autour des eaux vitales du Nil.
La rédaction








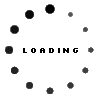
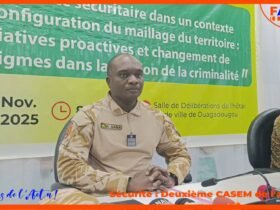




Laisser une réponse